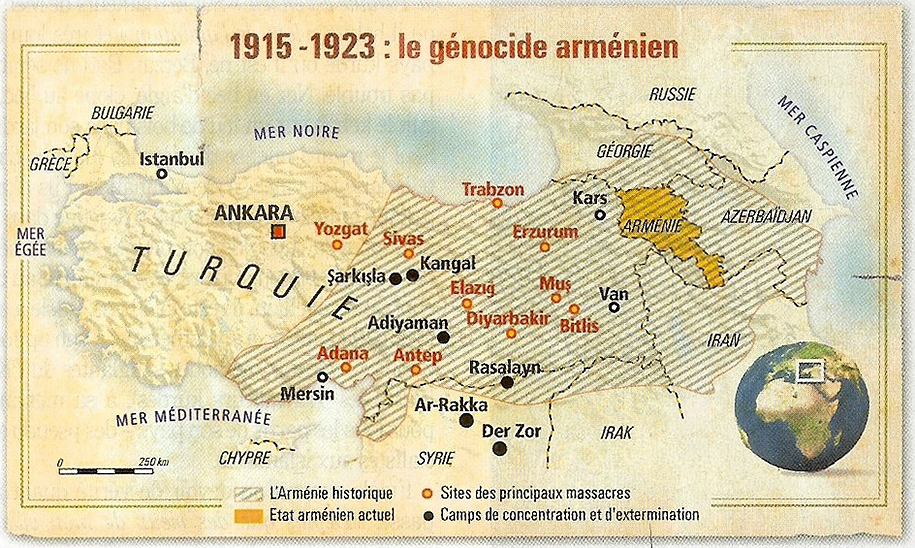« Ma conscience ne peut accepter que l’on reste indifférent à la Grande Catastrophe que les Arméniens ont subie en 1915, et qu’on la nie. Je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon. » : rédigé par quatre intellectuels turcs, ce texte a déjà recueilli près de 30 000 signatures
Sabri Atman est réfugié politique en Europe comme tant de ses compatriotes de la minorité assyrienne de Turquie. Il y a trois ans, sur un site kurde, Nasname.com, il découvre un article sur le génocide des Assyriens. Aujourd’hui encore, il en est encore tout retourné. « Les Turcs – comme le reste du monde – ignorent jusqu’à l’existence d’un problème assyrien, dit-il avec chaleur. Et voilà ce journaliste kurde qui parle des Assyriens massacrés avec les Arméniens en 1915, de ceux qui ont pu survivre en “devenant” kurdes et musulmans. Dans son article suivant, il dit sa honte d’avoir hérité de terres spoliées aux Assyriens et propose même de les leur rendre ! »
Cela fait des années que Sabri Atman fait des conférences aux quatre coins du monde et tente d’alerter sur le sort des rares Assyriens encore présents en Turquie, qui ont bien du mal à préserver l’araméen – la langue du Christ –, les monastères datant des débuts du christianisme et les villes ancestrales. Sabri est né dans un village assyrien aujourd’hui vidé de ses habitants originels et il n’y est jamais retourné. Le geste de Berzan Boti, le journaliste et philosophe kurde qui a brisé 90 années d’omerta, lui va droit au cœur.
Une discussion s’engage entre Boti et Atman, elle durera deux ans. Il faut d’abord s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un coup monté par les services turcs. Deuxième étape : comment réaliser la restitution ? Le centre Seyfo (« génocide » en araméen), un groupe de recherche fondé par Atman en Europe, ne peut selon la loi turque posséder de biens en Turquie. Il faut trouver un récipiendaire possédant la nationalité turque. Les Assyriens de l’intérieur sont terrorisés, et ceux de la diaspora craignent pour leur famille restée au pays. Ce sera donc Sabri Atman lui-même qui se dévouera. C’est à lui qu’il y a cinq mois, Boti a fait don par acte notarié de sa part d’héritage, une maison et des terres dans un village de la province de Siirt. La remise officielle se fera en mai, lors d’une cérémonie au parlement suédois. « Je vais être attaqué par les ultras turcs, prédit Sabri Atman. Mais ce ne sera rien comparé aux ennuis auxquels Berzan Boti s’expose en Turquie. Cet homme a un courage exceptionnel ».
Depuis que des vieux de mon village m’ont raconté les tueries auxquelles ils avaient participé, je ne peux me libérer d’un violent sentiment de honte et de culpabilité
Un article menaçant est déjà paru dans Milliyet : « Que fait le gouvernement ? Il devrait arrêter ce type louche dont les actes accréditent les allégations de génocide. L’avenir de la Turquie est en jeu ». Sur les hauteurs de Mersin où il habite « loin de l’agitation » et très loin du pays kurde où il est né, Berzan Boti ne semble pas troublé. Nez en bec d’aigle, clope au bec, il cuit le kebab sur un feu de bois dans son jardin. Seul le regard intense derrière les lunettes d’intello laisse deviner sa détermination. Fils d’une grande famille kurde, engagé très jeune dans la lutte pour la cause de son peuple, condamné à 11 ans de prison, torturé, constamment au cachot pour rébellion, il reste à 40 ans fidèle à ses idéaux de gauche, son athéisme, son opposition viscérale aux méthodes sanglantes du PKK (parti des travailleurs kurdes), sa méfiance pour tous les partis de son pays – des pseudo-socialistes aux islamistes. Fidèle surtout au devoir de vérité quant au passé. « Depuis que des vieux de mon village m’ont raconté les tueries auxquelles ils avaient participé, se souvient Boti, je ne peux me libérer d’un violent sentiment de honte et de culpabilité. À chaque fois que je croise un Arménien ou un Assyrien, je lui demande pardon. Mais ce n’est pas assez. Il faut rendre tout ce qui leur a été volé, dans l’espoir que leurs descendants voudront bien revenir parmi nous. Ce n’est pas une cause particulière que je défends. Je veux la liberté et la justice pour tous, afin que nous puissions de nouveau vivre ensemble. » Dût-il pour cela retourner pour le restant de ses jours dans les terrifiantes prisons de sa jeunesse.
Un voyage à Erevan
Berzan Boti est spécialement fier du soutien de sa mère. La tête couverte d’un mince voile blanc et les yeux rongés par une vie de larmes et de deuils, cette vieille dame kurde n’a jamais voulu quitter sa région proche de la frontière irakienne. Son visage s’illumine dès qu’elle parle du village. Pourtant, ce n’est qu’un hameau d’une dizaine de maisons sans charme, reconstruites après avoir été rasées par l’armée turque qui soupçonnait un soutien à la guérilla. Au sommet des collines nues qui ceignent l’horizon, des postes d’observation militaires surveillent la plaine désolée – dont une petite fraction appartient désormais au Centre Seyfo. Dans le hameau voisin, elle désigne un terrain vague poussiéreux – un « cimetière arménien » qui a perdu ses croix depuis bien longtemps –, et soupire encore en pensant à tout ce sang versé.
Il n’y a presque pas un Kurde qui ne découvre aujourd’hui qu’il a une grand-mère arménienne, mariée de force
« Le peuple kurde est en train de payer la note du passé, explique l’écrivain Orhan Miroglu. Nous avons commis le génocide. Il est vrai que les chefs féodaux kurdes étaient instrumentalisés par le pouvoir Jeune-Turc, mais ils ne sont pas innocents, ils ont accepté de faire le sale boulot ». Miroglu en sait quelque chose. Ses propres oncles, seigneurs de la région de Batman, ont perpétré les massacres. Et puis la machine génocidaire s’est retournée contre eux, et les a dévorés. Deux générations plus tard, la vérité surgit dans toute sa cruauté. « Il n’y a presque pas un Kurde qui ne découvre aujourd’hui qu’il a une grand-mère arménienne, mariée de force. Nous sommes issus de ce mélange de gènes. C’est seulement en reconnaissant notre part arménienne et notre crime contre les Arméniens que nous pourrons essayer d’atténuer – peut-être – leur souffrance ».
La majorité des 28 députés kurdes, ainsi que le président du DTP (parti kurde, proche du PKK), n’hésitent plus à reconnaître publiquement la responsabilité de leur peuple dans les crimes de 1915. Plus remarquable encore, ils sont aujourd’hui rejoints par des Turcs sur la voie de la repentance. « Ma conscience ne peut accepter que l’on reste indifférent à la Grande Catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915, et qu’on la nie. Je rejette cette injustice et, pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon ». Ce court texte, rédigé par trois intellectuels d’Istanbul et mis en ligne en décembre 2008 (1) a recueilli 30 000 signatures en quelques jours. Un chiffre étonnant, qui déborde largement l’intelligentsia occidentalisée. Inouï surtout si l’on songe à la force du négationnisme d’État et au risque de condamnation pour « atteinte à l’identité turque » en vertu de l’article 301 – un texte de loi qui a été brandi contre le prix Nobel Orhan Pamuk, et contre le journaliste arménien Hrant Dink.
En tant que Turc et musulman, j’ai bénéficié de l’héritage de l’Empire ottoman, je dois aussi en assumer le passif
L’assassinat de ce dernier, il y a deux ans, sur un trottoir d’Istanbul, est reconnu par tous comme le grand déclencheur de cette vague de repentance. « Hrant nous a laissé une mission : lutter contre l’amnésie historique comme il l’a fait au prix de sa vie, explique Ali Bayramoglu, un des initiateurs de la pétition. L’État n’est pas le seul à devoir régler les dettes du passé – la société doit le faire également. En tant que Turc et musulman, j’ai bénéficié de l’héritage de l’Empire ottoman, je dois aussi en assumer le passif ». Pour la célèbre danseuse Zeynep Tanbay, qui veut demander publiquement pardon aux Arméniens depuis le jour où Hrant est tombé, ces signatures révèlent un véritable mouvement citoyen. Avec ses amis de l’association Dur-de qui lutte contre le racisme et le nationalisme, elle prépare un voyage à Erevan sur la lancée de la campagne d’excuse. Une autre association de jeunes envisage une marche pacifique vers la frontière arménienne, scellée depuis des années.
Pour les Arméniens d’Istanbul, cette empathie nouvelle est un précieux cadeau. « Nous l’attendions depuis longtemps, et nous remercions ceux qui ont eu le courage de prononcer le mot “pardon” », explique Étienne Mahçubyan, successeur de Hrant Dink à la tête de l’hebdomadaire Agos. Là où leurs aînés rasaient les murs et restaient confinés dans les limites étroites de la communauté, les jeunes osent désormais animer une radio sur internet, fonder des associations « visibles », faire des projets avec des Turcs. « Le chemin qui a été ouvert par la mort de Hrant peut mener très loin, estime le directeur d’Agos. Déjà la dynamique a touché les cercles conservateurs. Le parti au pouvoir, par exemple, veut clairement améliorer ses relations avec l’Arménie, même si la question du génocide reste difficile à régler ».
Difficile mais pas insurmontable, si l’on en croit Gökhan Bacik, professeur de sciences politiques à l’université Fatih. Ce jeune intellectuel musulman – il se dit « conservateur » mais récuse l’étiquette d’« islamiste » – appartient à la mouvance Fethullah Gülen proche du parti au pouvoir. Cette école soufie moderne, très investie dans l’éducation, déclare travailler à l’entente et la paix dans le monde. Dans ses articles, le jeune professeur rappelle à ses amis musulmans qu’ils ne sont pas les héritiers de l’ultranationalisme des Jeunes-Turcs et de leur mentalité anti-arménienne, ayant eux-mêmes souffert du nationalisme étatique. « Je veux ouvrir ce débat parce que la démocratisation de la Turquie en dépend. Je veux un État de droit, libéral, inclus dans l’UE et qui reconnaisse mes droits et mes libertés, y compris en tant que musulman » , déclare Gökhan Bacik. Il n’a pas signé la pétition d’excuse, mais ce n’est pas par timidité. Pour lui, c’est le gouvernement turc qui doit non seulement demander pardon aux Arméniens, mais également verser des compensations pour leurs pertes. Et même offrir le passeport turc à leurs descendants !
Les démons du passé
C’est peut-être la même audace qui anime Naif Alibeyoglu. Maire (élu sur une liste islamiste) de Kars, aux portes de l’Arménie, dans une région que la fermeture de la frontière a transformée en cul-de-sac économique, il se bat pour la réconciliation. Un étonnant monument pour la paix est en cours d’achèvement, une sculpture colossale de 35 mètres de haut, plantée sur la colline qui domine la ville. Deux silhouettes se font face, comme les deux moitiés d’une même entité. L’une tend la main vers l’autre, tandis que les larmes de cette dernière remplissent un bassin au pied du couple. L’allusion – transparente – a déplu à l’opposition nationaliste qui a mené une guerre judiciaire, retardant la construction. Du coup, le maire en a modifié le nom : « Ce sera la statue de l’Humanité de Kars, comme celle de la Liberté qui est à New York ». S’il gagne les élections du 29 mars, il inaugurera le monument au printemps.
Les démons du passé ont-ils disparu ? On peut en douter. Les moines du monastère assyrien Mor Gabriel se demandent avec angoisse s’ils ne vont pas être expulsés. Les villageois voisins, visiblement téléguidés, réclament en effet des terrains de l’enclos monacal. Pire, le gouvernement ne fait pas mystère de son soutien. Pourquoi ? « Depuis le début du processus d’adhésion à l’UE, les minorités ont repris confiance, explique un proche du monastère. “Ils” veulent nous faire peur, pour nous pousser à partir ». Une manière soft de parachever la tâche entreprise il y a bientôt un siècle.
Parution Le Nouvel Observateur 12 mars 2009 — N° 2228